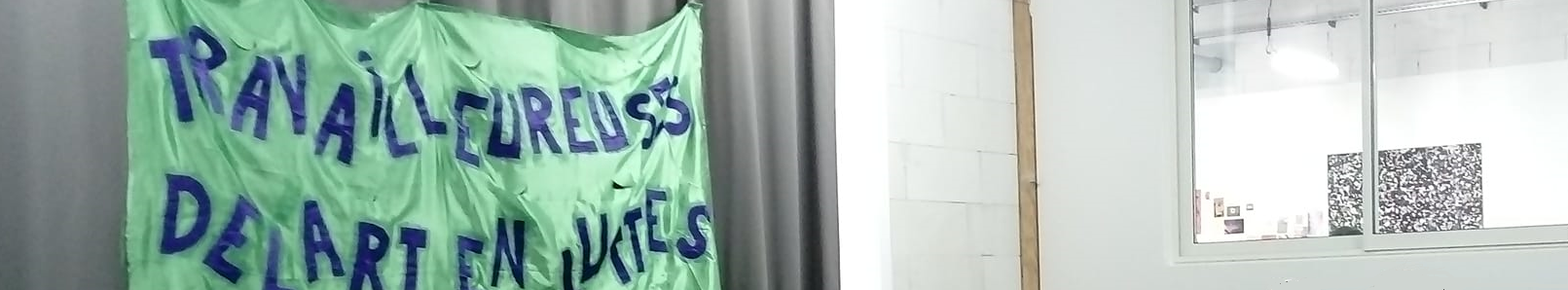par Aurélien Catin
Collectif La Buse et Réseau Salariat
mis en ligne le 29 janvier 2024
Depuis la période révolutionnaire, le domaine de la création est régi par un corpus juridique qui escamote la question de la production derrière des droits de propriété intellectuelle. Ce n’est que récemment que des organisations d’artistes se sont reconfigurées autour de la notion de travail et que certaines d’entre elles ont commencé à formuler des revendications salariales.
Ce phénomène a pris de l’ampleur en 2019 avec le mouvement Art en grève qui a rassemblé sous une même bannière des individus et des collectifs déterminés à lutter pour la reconnaissance du travail artistique[1]. Dans des mondes de l’art de plus en plus féminisés où l’accès aux plus hauts niveaux de reconnaissance est encore contrôlé par des réseaux très masculins[2], les analyses féministes se révèlent de puissants vecteurs de mobilisation et une composante importante de cette nouvelle dynamique militante. En outre, elles permettent de politiser le sujet de la rémunération en abordant le salaire comme un instrument de transformation sociale.
L’article qui suit a été écrit par un acteur des luttes en cours. En tant qu’auteur et militant, je suis partie prenante des mouvements que je m’attache à présenter. J’en propose une lecture orientée qui se nourrit de travaux scientifiques autant que d’observations empiriques. Mon texte résulte de la conjonction de deux points de vue complémentaires parfois difficiles à concilier.
Situation. La propriété comme obstacle à l’institution du travail
Le droit de la propriété intellectuelle distingue deux types d’artistes : les auteurs au sens large, dont l’activité relève de la création[3], et les interprètes, communément considérés comme des travailleurs. Aux côtés des ouvriers et techniciens du spectacle, ces derniers se sont mobilisés pendant plus d’un siècle pour bénéficier des conquêtes attachées à l’emploi. Cette stratégie leur a permis d’obtenir une présomption de salariat et d’entrevoir un dépassement de l’emploi à travers un régime d’assurance chômage connu sous le nom d’intermittence[4]. De leur côté, les créateurs se sont longtemps tenus à l’écart des mobilisations sociales. En effet, l’activité des dramaturges, des écrivaines et des paroliers, comme celle des peintres, des sculptrices et des graveurs, n’a pas été en premier lieu validée par les institutions du travail mais par la propriété littéraire et artistique dont découlent les droits d’auteur. Cette catégorie d’artistes a donc construit son identité sur un rapport de propriété, réputé garant d’une certaine liberté, en opposition au travail (ou pire, au salariat), décrit comme le lieu de la subordination.
En France, les premières lois sur le droit d’auteur furent votées pendant la Révolution. Issue du « domaine de la pensée »[5], pourvoyeuse d’inattendu, la création était alors entourée d’une aura positive. Le vocabulaire usité dans les débats parlementaires évoquait la renommée, la vigueur et la volonté, des attributs traditionnellement associés au masculin[6]. Très tôt, la pratique artistique a été assimilée à un exercice de « développement », source de progrès, d’innovation et d’accomplissement personnel. Pour l’artiste féministe Mierle Laderman Ukeles, les « systèmes de développement » se démarquent des tâches de « maintenance », ancrées dans la banalité du quotidien, déconsidérées et généralement assignées aux femmes[7]. C’est pourtant cette intention de faire de l’art une activité supérieure qui s’est retournée contre les créateurs en les séparant d’un monde ouvrier combatif et enclin à l’action collective. Isolés, repliés sur un corpus juridique dont on peut dire qu’il légitime l’ontologie différentialiste qui alimente les débats de la période révolutionnaire, ils n’ont pas été en mesure de faire reconnaître leur contribution à la production de valeur. Comme nous allons le voir, les créateurs pâtissent aujourd’hui de la fragilité de leurs revenus, de la faiblesse de leurs droits sociaux et d’une image de passionnés à qui la société doit apporter son aide[8].
Bien entendu, ce tableau esquissé à grands traits ne saurait faire oublier les initiatives qui ont contribué, à différents niveaux et avec un succès inégal, à le nuancer. En France, par exemple, une réforme impulsée par Jean Zay, ministre des Beaux-Arts issu du Front populaire, jeta les bases d’un changement de paradigme. Elle prévoyait la requalification des artistes en « travailleurs intellectuels » et leur intégration partielle au droit commun. Le projet de Jean Zay fut suspendu par la guerre, détricoté par le régime de Vichy et enterré par la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique[9]. Dans le monde anglo-saxon, des expériences autonomes s’attachèrent à démystifier la figure de l’artiste et à rapprocher les créateurs des grandes luttes politiques. Ce fut le cas notamment de l’Art Workers’ Coalition fondée à New York en 1969[10]. Très avancée dans l’articulation des analyses antiracistes, écologistes et féministes, cette alliance informelle éprouva toutefois des difficultés à sortir du cadre existant. Ses propositions sur le statut des artistes se limitèrent à l’instauration de rémunérations spécifiques comme les honoraires d’exposition et le droit de suite[11].
Pour de multiples raisons, ces initiatives n’ont pas réussi à renverser la conception de l’art comme activité séparée du travail et régie par des dispositifs exceptionnels. Ces échecs ont au moins un facteur commun : au contraire des interprètes, les créateurs ont toujours eu du mal à se définir comme des travailleurs, en partie parce que les institutions du salariat ont longtemps suscité leur défiance. Ces dernières années, des collectifs ont réactivé la mémoire des luttes passées et mis la question du travail au cœur de leurs réflexions. Une certaine détermination à lever le tabou du salaire s’est manifestée dans Art en grève, un mouvement né à Paris à la veille de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites de 2020.

Transformation. L’irruption des travailleuses de l’art
Avant d’aller plus loin, je précise que j’ai fait partie du groupe qui a rédigé l’appel à la grève du 27 novembre 2019[12]. Dans les réunions préparatoires à sa diffusion, puis dans le mouvement Art en grève, les femmes étaient majoritaires, comme elles le sont dans les organisations qui en découlent ou qui portent des revendications analogues. Dans le reste du texte, je prendrai donc le parti de « renverser l’universel » en employant le féminin pour désigner l’ensemble des travailleur·ses de l’art[13]. Par ce choix, j’entends souligner la dimension de genre de la bascule des représentations qui s’y opère.
Quelle que soit la discipline, qu’elle soit quantitativement masculine (cinéma, rap), mixte (arts plastiques, littérature) ou féminine (danse, théâtre), il est plus difficile pour les femmes de se professionnaliser[14]. En effet, les réseaux qui permettent de bâtir une carrière et d’accéder au succès demeurent essentiellement masculins, si bien que « la population des femmes artistes est d’autant plus élevée qu’est faible la légitimité artistique du lieu où elles apparaissent »[15]. Cela se traduit par de fortes inégalités de revenus qui entraînent des difficultés d’accès aux droits. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant de voir émerger une nouvelle dynamique militante mêlant critique des structures qui déterminent le travail artistique et contestation d’une domination masculine encore bien ancrée.
C’est dans ce cadre où s’articulent des enjeux de classe et des tensions liées au genre qu’a été lancé « Art en grève », un appel à cesser le travail adressé à un secteur dans lequel sept personnes sur dix ne sont pas salariées[16]. Il invitait les professionnelles des arts graphiques et plastiques, quel que soit leur statut, à rejoindre la mobilisation en tant que travailleuses concernées par le sort des régimes de retraite. L’appel plaçait les artistes « à l’avant-garde de l’absence de protection sociale » et se concentrait sur des points saillants qui vont nous permettre de décrire leur condition.
Tout d’abord, les créatrices sont mal payées et leurs droits sociaux incomplets. Mis en avant par les médias, le succès économique d’une poignée de vedettes est le paravent d’une pauvreté endémique. Dans les arts graphiques et plastiques, 53,1 % des artistes ont perçu moins de 8784 euros de revenus artistiques en 2017[17]. Un rapport commandé par le ministère de la Culture nous apprend que les écarts de ressources entre hommes et femmes y atteignent des sommets. Ainsi, le revenu médian global des plasticiennes est de 10 000 euros par an contre 15 000 pour les plasticiens. Les conclusions sont similaires dans tous les champs de la création. Dans la BD, par exemple, 50 % des autrices perçoivent des revenus qui les situent sous le seuil de pauvreté, contre 36 % des auteurs[18]. L’une des ambitions de l’appel à la grève était donc de pointer l’existence d’un « prolartariat créatif »[19] et de lui donner corps à travers l’arrêt du travail et la présence en manifestation.
Art en grève se proposait d’expliquer cette situation par le statut spécifique des artistes qui les empêche de se définir comme des productrices et de défendre efficacement leurs droits. Avant toute chose, il fallait donc populariser une façon de se désigner qui avait déjà été employée dans le monde anglo-saxon mais dont l’usage n’était pas courant en France. Les collectifs à l’origine de l’appel ont ainsi cherché à diluer la figure de l’artiste dans le grand ensemble des « travailleuses de l’art » qui englobe « toute personne exerçant une activité dans ce champ ». Sur ce plan au moins, la lutte a porté ses fruits puisque l’expression est désormais en circulation dans la plupart des organisations politiques et syndicales de transformation sociale.
Cette appellation, assurément polysémique, devait encore trouver un débouché dans l’action. La chose était loin d’être entendue pour le sous-ensemble des artistes, symbole du rejet du travail, dont la modeste énergie militante était plutôt tournée vers le code de la propriété intellectuelle. Art en grève devait donc donner une assise matérielle à la catégorie de travailleuse de l’art en appelant toutes les professionnelles du secteur à rejoindre les salarié·es dans la défense d’une institution interprofessionnelle de socialisation du salaire. Quoique d’aspect technique, ce point était au cœur de la stratégie du mouvement puisqu’il permettait d’expérimenter un postulat (« nous sommes toutes des travailleuses ») à la faveur d’une lutte fédératrice. En même temps, l’appel incitait les créatrices à « faire reconnaître [leurs] activités comme productrices de valeur économique ». C’est là sans doute que se sont manifestées les premières contradictions d’une initiative dont le but implicite était de poser l’horizon d’un « au-delà de l’emploi » via le droit politique au salaire[20]. Nous reviendrons sur ce point.
Car en effet, Art en grève appelait moins à lutter pour une bonne rémunération des activités artistiques qu’à s’engager aux côtés des différentes composantes du salariat pour bloquer une réforme qui prévoyait de supprimer le droit au salaire des retraité·es. Son appel visait à convaincre les professionnelles des arts graphiques et plastiques qu’elles avaient « les mêmes intérêts que l’ensemble des travailleur·ses ». Cette affirmation valait également pour les créatrices qui sont en partie intégrées aux institutions du salariat.
Bien entendu, elles ne sont jamais payées en salaire, sauf cas exceptionnels. La structure de leurs revenus repose sur trois piliers :
1° Les droits d’auteur sur l’exploitation des œuvres reproductibles. La propriété littéraire et artistique fait de l’œuvre un patrimoine, acquis par un travail non quantifiable, qui produit une rente proportionnelle à son succès commercial.
2° Les honoraires qui rémunèrent la cession d’œuvres uniques et la vente de prestations périphériques à la création (ateliers, conférences, expositions, interventions en milieu scolaire, etc.) Payés sur facture, ils relèvent du travail indépendant.
3° Les bourses et les aides à la création qui pallient l’insuffisance des deux premiers piliers.
Cependant, si ces modes de rémunération ne sont pas du salaire, les revenus qu’ils génèrent sont additionnés et convertis en heures Smic par la Sécurité sociale des artistes-autrices. Depuis les années 70[21], le régime des créatrices est adossé au régime général et leur ouvre les mêmes droits que les salarié·es pour la santé, les prestations familiales et la retraite[22]. Il est somme toute excessif de dire que les artistes sont « à l’avant-garde de l’absence de protection sociale », mais il est vrai que leur couverture est incomplète puisqu’elles n’ont ni assurance chômage ni indemnités en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Entre verre à moitié plein et verre à moitié vide, l’analyse produite par le mouvement Art en grève était conçue comme un point d’entrée. Elle préfigurait des luttes plus avancées pour l’assimilation des artistes-autrices au salariat pris comme classe et comme ensemble institutionnel. Mais l’objectif d’un « au-delà de l’emploi » n’était pas explicite. Il apparaissait en filigranes dans un appel qui cherchait à donner corps au prolartariat et à populariser des outils salariaux non réductibles à la subordination. Cet horizon quelque peu voilé laissait la porte ouverte à deux stratégies à priori divergentes.
Contradiction. Les deux supports du salaire
Les individus et les collectifs qui se sont fédérés dans Art en grève s’inscrivent dans la continuité de luttes féministes qui ont contribué à désenclaver les activités de la création. Dès la fin des années 60, des autrices comme Jacqueline Feldman se sont penchées sur les conditions d’exercice de la littérature[23]. Par une approche matérialiste, elles ont éclairé le fonctionnement de l’institution littéraire et favorisé la démystification des pratiques artistiques. Aujourd’hui, c’est dans les arts graphiques et plastiques que la militance des artistes-autrices est la plus combative. De nouvelles organisations d’étudiantes en art, de curatrices et de plasticiennes développent une critique de l’infrastructure qui détermine l’économie de la création. Elles transcendent les apports des luttes passées en portant la contestation sur le terrain du salaire et des droits sociaux plutôt que sur celui du patrimoine et des droits d’auteur. Cette volonté d’imposer une lecture alternative du statut des créatrices débouche sur deux voies d’action que le mouvement Art en grève n’a fait qu’ébaucher.
La première consiste à postuler que les activités artistiques produisent de la valeur et qu’elles doivent être rémunérées. C’est ce que défendent des collectifs comme WAGE[24] aux États-Unis, GARAGe[25] en Suisse ou Économie solidaire de l’art en France. À l’heure actuelle, la plupart des initiatives de ce type ne se soucient pas du mode de rémunération à conquérir. Elles se contentent de revendiquer la reconnaissance des activités périphériques à la vente d’œuvres sans s’appesantir sur ce qui distingue, par exemple, une bourse d’un salaire. Dans une telle configuration, la situation des artistes-autrices tend à se rapprocher de celle des travailleurs de plateforme dans plusieurs pays européens, entre travail indépendant et accès à un « socle réduit »[26] de droits salariaux. Or l’option d’un tiers statut est discutable. Certes, elle déplace l’action des créatrices en les détournant du paradigme propriétaire, mais elle risque de les épuiser dans la défense d’une forme d’« emploi dégradé »[27].
C’est pourquoi d’autres collectifs adoptent une position plus offensive et proposent que les mêmes activités soient rémunérées en salaire. C’est le cas du syndicat des travailleuses artistes-autrices (STAA CNT-SO) qui entend « mettre un terme à l’utilisation abusive du statut artiste-auteur de la part de diffuseurs voulant se dédouaner des cotisations sociales par la requalification en contrat salarié »[28]. Il s’agit de calquer la condition des créatrices sur celle des interprètes par l’application d’une présomption de salariat donnant accès au socle complet des droits attachés à l’emploi. Cette option présente deux avantages :
1° Elle n’enferme pas les artistes dans une logique de revenu. En effet, tous les modes de rémunération ne se valent pas. L’emploi au sens propre est caractérisé par le respect du code du travail, par l’attribution d’une qualification au poste et par la cotisation de sécurité sociale. Pris dans ce cadre, le salaire valide une contribution à la production de valeur et s’écarte d’une conception du revenu comme prix de la force de travail[29].
2° Elle s’inscrit dans le giron de l’emploi sans s’y enfermer. Le STAA revendique des droits fondés sur le contrat et demande que les diffuseurs soient assimilés à des employeurs. Néanmoins, les caractéristiques du travail artistique impliquent de mobiliser deux outils bien connus des intermittent·es : la présomption de salariat, qui distend la relation entre subordination et droits salariaux, et l’assurance chômage, qui garantit le maintien d’un salaire de référence entre les contrats. Ce sont de possibles prémices d’une sortie de l’emploi par le haut[30].
Pour autant, cette approche ne rompt pas avec la vision capitaliste du statut des travailleur·ses qui lie leurs droits économiques à la validation de leur activité. En évoquant le « droit au salaire pour les retraité·es », le mouvement Art en grève a défini les contours d’une seconde stratégie qui consiste à postuler que toute personne est en capacité de produire de la valeur. En conséquence, la rémunération doit être dissociée de l’activité et fondée sur une qualification personnelle. Cette voie d’action vise à inclure les créatrices dans la construction d’un « statut communiste du producteur »[31] posant le salaire comme droit politique. Plus généralement, il s’agit de faire que toute personne majeure soit dotée d’un premier niveau de qualification, irrévocable et inconditionnel, et de la rémunération correspondante[32].
Il est difficile de se projeter dans une abstraction qui peut paraître éloignée des réalités de nos métiers. Pourtant, la généralisation d’un statut économique garanti aurait sans doute des effets bénéfiques sur des pratiques artistiques de plus en plus soumises à des dynamiques de marchés et dépendantes du soutien de fondations d’entreprise. En tant qu’auteur, je dois produire en continu pour enchaîner les publications. Lorsque j’ai besoin de compléter mes revenus, je suis contraint de multiplier les prestations rémunérées, jusqu’à l’absurde. Titulaire d’un salaire à vie, je publierais moins mais mieux, sans crainte d’être économiquement sanctionné par la « non-validation sociale de [mon] produit »[33].
Certains collectifs plaident ainsi pour un modèle dissociant le statut des personnes de la nature de leur activité. C’est le cas de METAL[34], un groupe fondé en Belgique qui s’appuie sur les luttes en cours pour défendre « une définition du chômage comme reconnaissance de la qualité de productrice, même hors de l’emploi »[35]. En France, La Buse tente d’explorer des modalités d’accès au salaire à la qualification personnelle à partir de la situation des créatrices. Ce réseau de curatrices, d’enseignantes et de plasticiennes a coordonné la rédaction d’une tribune cosignée par des syndicats de travailleuses de l’art[36]. Les organisations signataires revendiquent un renforcement du régime des artistes-autrices par la création d’une assurance chômage « conçue comme un droit à la continuité du revenu »[37]. Elles envisagent une indemnisation mensuelle minimum de 1700 euros accessible à partir d’un bénéfice annuel de 3000 euros, soit 266 heures Smic. À l’instar de METAL, La Buse affirme que le maintien du salaire entre les contrats « pose chacune comme pleinement productrice » et préconise un début de déconnexion entre la rémunération des créatrices et leur activité. Inspirée du « déjà-là »[38] du régime général de Sécurité sociale, sa tribune interroge explicitement la définition de la valeur et le statut économique des personnes. Cependant, sa proposition ne va pas jusqu’au bout du raisonnement. Elle sert une stratégie critique de l’emploi qui ne conçoit pas de rupture immédiate. L’absence de réflexion sur la qualification des artistes est sans doute un frein au développement d’un mouvement qui assumerait pleinement les conséquences de ses analyses.
Mais derrière la théorie se pose une question pratique qui touche au rapport de force et à l’état des représentations dans les milieux artistiques : comment les créatrices, qui sont encore nombreuses à se sentir étrangères aux institutions du salariat, peuvent-elles s’approprier les enjeux du droit politique au salaire ? L’expérience nous enseigne que la bataille pour la requalification de leurs activités en travail peut être un point d’appui pour se projeter au-delà de l’emploi.

Articulation. Du salaire pour changer le travail
En effet, chaque secteur s’inscrit dans la lutte des classes selon des logiques qui lui sont propres. Les organisations de transformation sociale doivent y être attentives afin d’identifier des voies d’action fructueuses. Dans les arts graphiques et plastiques, les mobilisations pour la reconnaissance des activités périphériques à la vente d’œuvres sont un terreau propice à la sensibilisation des travailleuses aux thématiques salariales. Par ailleurs, dans ce milieu où la production est souvent camouflée en passion et où les femmes représentent 68 % des étudiant·es en écoles d’art[39], la définition du travail est un sujet crucial et sa dimension de genre particulièrement tangible. Plusieurs collectifs font ainsi référence au mouvement international pour le salaire au travail ménager initié par des féministes marxistes dans les années 70[40]. Le groupe WAGE, par exemple, se réclame des écrits de Silvia Federici[41]. Lancée en Suisse en 2017, la campagne Wages For Wages Against puise aux mêmes sources pour « questionner les logiques néolibérales qui sous-tendent les milieux de l’art contemporain »[42]. De son côté, La Buse invoque régulièrement l’expérience québecoise des comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE) qui ont animé une grève des stages autour de mots d’ordre inspirés du mouvement pour le salaire au travail ménager[43].
Une part de la politisation du secteur s’opère donc à la jonction de conflits sur la rémunération et de luttes féministes porteuses d’une réflexion sur le périmètre du travail. En résulte une conception du salaire qui n’est pas sans rapport avec la revendication d’un statut économique garanti.
1° Elle permet de démystifier l’aspect vocationnel de la création et d’excéder la figure historique du travailleur, longtemps cantonnée dans l’emploi industriel masculin.
2° Elle légitime le terme de travailleuse et lui donne une charge symbolique positive. Elle autorise des personnes extérieures au salariat, souvent privées de ressources au nom de valeurs comme la passion, à dénoncer des formes de travail gratuit en s’emparant des « instruments de la conflictualité salariale »[44].
3° Elle rappelle que le salaire n’est pas qu’une question de revenu mais « l’expression fondamentale d’une relation de pouvoir entre le capital et la classe laborieuse »[45]. Dans un secteur accoutumé aux aides et acquis au paradigme du droit d’auteur, cette politisation de la rémunération est précieuse.
Toutefois, il n’est pas question de nier les limites d’une stratégie centrée sur l’activité. Nous ne sortirons pas du capitalisme en adoptant sa vision du salaire comme contrepartie d’un travail validé. Une telle adhésion nous soumet à l’agenda d’une classe dirigeante qui contrôle le marché de biens et services et qui façonne le marché du travail au gré de ses intérêts. Le risque est de buter contre le mur du chantage à l’emploi ou de tomber dans les chausse-trapes de l’infra-emploi que sont les tiers statuts et le revenu de base. C’est pourquoi il faut rappeler avec Anne Dufresne que toute lutte salariale devrait avoir pour ambition de « se passer de donneurs d’ordre […] pour une émancipation salvatrice et une redéfinition du travail en tant que tel »[46].
Ceci dit, la seule perspective du salaire à la qualification personnelle est insuffisante. Certes, elle permet de se démarquer du statut capitaliste des travailleur·ses, mais elle n’épuise pas le débat sur le contenu d’une production qui inclut des activités écocidaires, des emplois inutiles, une division des tâches inique, et qui reconduit des dominations de genre. Outre qu’elles constituent un ressort de mobilisation, les approches féministes du salaire nous aident à penser les contours du travail à partir d’expériences minoritaires. Elles pointent des conflits à l’œuvre dans la question de la rémunération et montrent que celle-ci n’est pas une fin en soi mais « un point de départ vers l’expression d’une autonomie politique »[47]. En pratique, elles favorisent l’orientation de nouvelles dynamiques militantes vers des outils préfigurant le dépassement de l’emploi. À l’aune de leur apport, la construction de la maîtrise collective du travail artistique pourrait emprunter ce chemin : « identifier [le communisme] à des institutions familières »[48], populariser le salaire comme moyen d’action, et faire de la qualification personnelle le support légitime des droits économiques.
[1] Maïlys Celeux-Lanval, « Pourquoi les artistes se mettent-ils eux aussi en grève ? », Beaux Arts Magazine, 6 décembre 2019. https://www.beauxarts.com/grand-format/pourquoi-les-artistes-se-mettent-ils-eux-aussi-en-greve/
[2] Marie Buscatto, « Femme et artiste : (dé)jouer les pièges des ‘‘féminités’’ », in Isabelle Berrebi-Hoffmann (dir.), Politiques de l’intime. Des utopies sociales d’hier aux mondes du travail d’aujourd’hui, Paris, La Découverte, 2009, p. 266-267.
[3] Fondée sur la notion d’originalité, la différence entre travail et création est au cœur des débats sur le droit d’auteur. On la retrouve dans différents manuels destinés aux mondes de l’art dont Jean Vincent, Droits d’auteur et droits voisins, 2e édition, Nantes, M Médias, Coll. « La Scène, aide-mémoire », 2016, p. 12-13.
[4] Mathieu Grégoire, Les intermittents du spectacle. Enjeux d’un siècle de luttes, Paris, La Dispute, 2013.
[5] Assemblée nationale constituante, comité de Constitution, Rapport fait par M. Le Chapelier sur la pétition des auteurs dramatiques, 13 janvier 1791.
[6] Le député Le Chapelier loue le « glorieux travail » des dramaturges et des « génies qui ont rendu la France célèbre ». Il se fait le relai de ceux qui parlent « avec énergie de liberté » et défend la libéralisation du théâtre : « Le perfectionnement de l’art tient de la concurrence. Elle excite l’émulation, elle développe le talent, elle entretient des idées de gloire ». Ainsi, le statut sexuel des femmes « vient en contradiction avec les caractéristiques auxiliaires attachées à la profession d’artiste » (Dominique Pasquier, « Carrières de femmes : l’art et la manière », in Sociologie du travail, 25e année, n° 4, octobre-décembre 1983, Les professions artistiques, Paris, Dunod, p. 419).
[7] Mierle Laderman Ukeles, « Manifeste ! Pour un art de la maintenance – Proposition pour une exposition », in S. Cras, Écrits d’artistes sur l’économie, une anthologie, Paris, Éditions B42, 2022, p. 93-97.
[8] L’aide est un mode de rémunération ordinaire des activités artistiques, comme en témoigne la brochure éditée par le Centre national des arts plastiques en 2012, 140 aides privées et publiques en faveur des artistes.
[9] Anne Latournerie, « Petite histoire des batailles du droit d’auteur », Multitudes, 2001/2, n° 5, p. 49-53.
[10] Lucy R. Lippard, ‘‘The Art Workers’ Coalition: Not a History’’, Studio International, 1970, vol. 180, n° 927.
[11] Le droit de suite accorde à l’artiste un pourcentage du prix de revente de son œuvre.
[12] L’appel est en ligne sur Paris-luttes.info : https://paris-luttes.info/appel-aux-travailleuses-et-au-13012
[13] Ce parti pris s’inspire d’une proposition de Maud Simonet dans Travail gratuit : la nouvelle exploitation ?, Paris, Textuel, 2018, p. 12.
[14] Marie Buscatto, « Entrer, rester, être reconnue : les conditions de féminisation des mondes de l’art », entretien filmé pour le projet Visuelles.art, 2018. https://visuelles.art/les-entretiens/
[15] Dominique Pasquier, « Carrières de femmes », art. cit., p. 421.
[16] Alain Hayot (dir.), Culture en force !, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2019, p. 195.
[17] Maison des artistes, Rapport d’activité. Année 2018, p. 12.
[18] Bruno Racine, L’auteur et l’acte de création, ministère de la Culture, janvier 2020, p. 25.
[19] Olivier Quintyn, « La valeur somptuaire de l’art et la pauvreté des artistes », in J.-P. Cometti, N. Quintane (dir.), L’art et l’argent, Paris, Éditions Amsterdam, 2017, p. 44.
[20] Sur la « sortie de l’emploi par le haut » et le droit politique au salaire, voir Bernard Friot, Vaincre Macron, Paris, La Dispute, 2017.
[21] Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.
[22] Les artistes-autrices ont la même assurance maladie que les salarié·es dès le premier euro déclaré. Elles valident quatre trimestres de retraite à partir de 600 heures SMIC, soit environ 6700 euros de revenu brut, et peuvent bénéficier de congés maladie et d’indemnités journalières de maternité.
[23] Delphine Naudier, « La cause littéraire des femmes dans les années 1970 », in M. Reid (dir.), Femmes et littérature. Une histoire culturelle, II, Paris, Gallimard, 2020, p. 388.
[24] Working Artists and the Greater Economy.
[25] Groupe d’action pour la rémunération des artistes à Genève.
[26] Anne Dufresne, « La bataille des statuts. Les dessous de la loi européenne pour les travailleurs de plateforme », Salariat, octobre 2022, n° 1.
[27] Ibid.
[28] Présentation du STAA sur le site de la CNT-SO : https://cnt-so.org/lancement-du-syndicat-des-travailleurs-artistes-auteurs-staa
[29] Bernard Friot, Vaincre Macron, op. cit., p. 33-42.
[30] C’est l’une des thèses développées dans Aurélien Catin, Notre condition. Essai sur le salaire au travail artistique, Saint-Denis, Riot Éditions, 2020.
[31] Bernard Friot, Vaincre Macron, op. cit., p. 12.
[32] Le salaire à la qualification personnelle est expliqué en détail dans Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail. Conversations sur le communisme, Paris, La Dispute, p. 30-44.
[33] Ibid, p. 30.
[34] Mouvement des étudiantes travailleuses des arts en lutte.
[35] METAL, « En finir avec l’artiste. Continuité d’une lutte de discontinues », Théâtre/Public, janvier-mars 2022, n° 242, p. 59.
[36] Le STAA, SUD Culture, le syndicat national des artistes plasticiennes (SNAPcgt) et le syndicat national des écoles d’art et de design (Snéad-CGT).
[37] La tribune est en ligne sur le blog de La Buse : https://blogs.mediapart.fr/la-buse/blog/221221/garantir-un-droit-la-continuite-du-revenu-aux-travailleur-euses-de-l-art-0
[38] Bernard Friot, « Le salaire universel : un déjà-là considérable à généraliser », Mouvements, 2013/1, n° 73, p. 60-69.
[39] Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, ministère de la Culture, 2022, p. 6.
[40] Sur ce sujet, voir Silvia Federici, Wages Against Housework, Bristol, Falling Wall Press, 1975.
[41] En 2015, Lise Soskolne de WAGE a participé à une table ronde avec Silvia Federici. Le texte de son intervention peut être consulté en ligne : https://wageforwork.com/files/dnOjerAJO6TgJl8Z.pdf
[42] Tiphanie Blanc, « Wages For / Wages Against », in Wages For Wages Against, We are not where we need to be but, we ain’t where we were, Bruxelles/Genève, L’Amazone/Privilege, 2021, p. 7.
[43] Collectif, Grève des stages, grève des femmes. Anthologie d’une lutte féministe pour un salaire étudiant (2016-2019), Montréal, Éditions du Remue-ménage, 2021.
[44] Maud Simonet, Travail gratuit, op. cit., p. 146.
[45] Ibid, p. 33. Citation de Nicole Cox et Silvia Federici.
[46] Anne Dufresne, « La bataille des statuts », art. cit.
[47] Valérie Simard, « (Psych)analyse d’une grève », in Grève des stages, grève des femmes, op. cit., p. 62.
[48] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, op. cit., p. 15.